Depuis 2021, je coordonne une étude sur l’alimentation en détention. L’objectif scientifique de cette étude est de répondre aux questions suivantes :
- Qu’est-ce que les détenus mangent?
- Qu’est-ce qu’ils ne mangent pas ?
- Pourquoi mangent-ils certaines choses et pas d’autres ?
Pour répondre à ces questions, notre équipe a mené l’enquête dans cinq établissements pénitentiaires du territoire français.
Un travail d’enquête rigoureux
Nous avons utilisé plusieurs méthodes de collecte de données, aussi bien qualitatives que quantitatives.
- Nous avons mené des observations participantes. En cuisine, nous avons cherché à comprendre comment les repas sont préparés. Dans les coursives, nous avons voulu savoir comment les repas sont servis. Dans les cellules, nous avons souhaité assister à la consommation des repas. Si nos observations sont « participantes », c’est parce que nous avons contribué aux actions observées. Par exemple, nous avons fait la plonge et préparé les plats chauds en cuisine, distribué le pain dans les coursives, et partagé un repas avec des personnes détenues volontaires dans leur cellule.
- Nous avons également conduit des entretiens avec des personnes détenues, mais aussi avec des personnels de l’Administration Pénitentiaire, et des salariés de différents prestataires de restauration. En adoptant plusieurs points de vue, nous avons pu identifier les problèmes que l’alimentation en détention soulève pour l’ensemble des personnes concernées.
En accumulant et croisant les observations participantes et les entretiens, nous avons obtenu des résultats riches et solides. Pour accroitre encore la validité de nos résultats, nous avons complété l’étude qualitative par une étude quantitative.
- Nous avons construit un questionnaire anonyme que nous avons distribué et récupéré en main propre auprès de la population pénale.
- Nous avons réalisé une analyse statistique des achats alimentaires en cantine sur une période de un an. Ceci nous a permis de découvrir quels produits alimentaires sont particulièrement prisés en détention, notamment selon le budget dont les détenus disposent.
Grâce à ces quatre méthodes, nous avons obtenu des résultats fiables, robustes, et intrigants.
Des résultats passionnants à rebours des idées reçues
Tout au long de notre étude, nous avons entendu de nombreuses idées reçues:
- « Les détenus ne mangent pas de légumes, tout ce qu’ils veulent ce sont des frites et des burgers »
- « Ils ne savent rien faire, même pas se faire cuire un œuf ».
- « Si les repas finissent à la poubelle, c’est parce qu’ils ne sont pas bons ».
Nos résultats remettent en question ces idées reçues. Ils montrent que les préférences et habitudes alimentaires des personnes détenues sont diverses,et que les raisons qui conduisent à rejeter les repas du chariot sont complexes.
Notre étude révèle que la détention génère de multiples transformations corporelles (ex : perte et prise de poids, manque d’énergie, problèmes digestifs) ainsi qu’une difficulté à s’alimenter sainement. Ces perturbations finissent par susciter un intérêt pour ce qui touche à l’alimentation. Dès lors, les personnes détenues acquièrent des connaissances en matière de nutritionet des compétences culinaires au cours de leur incarcération. Elles cherchent à (re)préparer leurs repas en cellule, et ainsi à retrouver une certaine autonomie sur le plan alimentaire. Préparer ses repas en autonomie s’inscrit dans un mode de vie qui consiste à « se prendre en main ». Les repas tout préparés servis quotidiennement aux personnes détenues ne répondent pas au besoin d’autonomie créé par l’incarcération. Les repas sont donc dépréciés et leur consommation devient une source de honte.
Si notre recherche est une première en France, des études similaires ont été menées dans d’autres pays du Monde au cours des 25 dernières années. Plusieurs de nos résultats font écho à ce qui se passe à l’étranger. Quel que soit le pays où elles sont incarcérées, les personnes détenues cherchent à retrouver de l’autonomie sur le plan alimentaire.
Pourquoi cette étude sur l’alimentation en détention ?
En nous appuyant sur les résultats de notre étude, nous proposons des recommandations concrètes applicables à court terme et à long terme afin de transformer le système actuel de restauration en détention. Le nouveau modèle que nous proposons présente de nombreux avantages :
- Diminution drastique du gaspillage alimentaire
- Augmentation des chances de réinsertion
- Conditions de vie plus dignes en détention
- Amélioration des conditions de travail des surveillants
- Réduction des coûts
Nos recommandations vont dans le sens de l’intérêt général. Elles permettent d’aligner des intérêts a priori divergents : ceux des personnes détenues, ceux de l’Administration Pénitentiaire, ceux de l’Etat, et ceux de la société.
Nos textes
Suite au vaste travail d’enquête que nous avons mené, nous avons rédigé des textes destinés à différents publics.
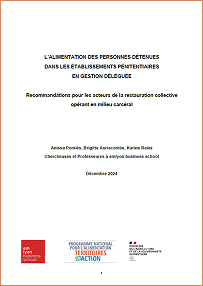
L’alimentation des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires en gestion déléguée
Ce rapport s’adresse auMinistère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire qui a co-financé une partie de notre recherche dans le cadre du Programme National de l’Alimentation. Ce rapport se concentre sur les établissements en gestion déléguée. Il a fait l’objet d’une présentation orale aux représentants de la DGAL et aux prestataires de restauration en juillet 2024.

La restauration et l’alimentation des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires français
Ce rapport a été écrit pour la Direction de l’Administration Pénitentiaire qui a financé une partie de la recherche menée dans les établissements en gestion publique. Il a fait l’objet de trois présentations orales entre février et mai 2025.
Légende : Nathalie O’Mahony, Karine Raïes, Anissa Pomiès et Brigitte Auriacombe (de gauche à droite)
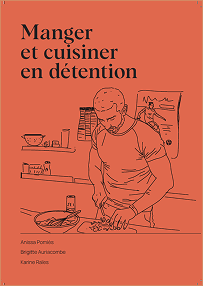
Manger et cuisiner en détention
Le livre « Manger et cuisiner en détention » a été écrit à l’attention des personnes détenues. Il a été imprimé en 700 exemplaires afin d’être diffusé dans les bibliothèques de tous les établissements pénitentiaires du territoire.

Des hommes capables
« Des hommes capables » est un roman qui s’adresse au grand public. Au fil des chapitres, les lecteurs découvrent la réalité carcérale dans sa banalité. Ils rencontrent des hommes aux histoires singulières et parcours accidentés. Des hommes dont le corps est devenu l’ultime espace de liberté, et le repas un enjeu existentiel. Des hommes dont ce roman se propose de faire entendre la voix.
Une équipe pluridisciplinaire et complémentaire
L’étude a été réalisée par une équipe réunissant des personnes aux expertises complémentaires. Si j’ai piloté l’étude et fait du terrain dans tous les établissements, je n’aurais jamais pu mener ce vaste travail de recherche seule. J’ai eu la chance de travailler avec plusieurs personnes à des étapes différentes du projet.
Karine Raïes
emlyon
Karine est spécialiste de la consommation et des méthodes quantitatives. Elle a réalisé l’étude quantitative par questionnaire.
Brigitte Auriacombe
emlyon
Brigitte est spécialiste des expériences de service et des méthodes qualitatives. Elle a contribué à l’étude qualitative.
Nathalie O’Mahony
emlyon
Nathalie est spécialiste des achats en B2B et des questions d’approvisionnements alimentaires. Elle a contribué à l’étude qualitative.
Anne Ponseille
Université de Montpellier
Anne est juriste, spécialiste du droit de la sanction pénale. Elle a veillé à la conformité des recommandations avec le cadre juridique et légal.
Jean Savinien
emlyon
Jean est data scientist. Il a réalisé l’analyse des bases de données d’achats en cantine.
Miriam Farias
emlyon
Miriam est postdoctorante et assistante de recherche. Elle a contribué à l’étude qualitative.